  |  |  |  |  |  |  | Partager : |  |  |  |  |  |  |  |  |
Fonterra et les trois paradoxes de l'économie laitière
[ 07/10/09 ] 5 commentaire(s)
Une fois de plus, les tracteurs ont repris le chemin du centre-ville de Bruxelles. A nouveau, les agriculteurs ont crié leur colère, épuisés par un métier pénible qui ne paie plus son homme. La faute à ces ministres européens, incapables de s'entendre pour soutenir leurs paysans, la faute à l'Europe, la faute à… La faute surtout à ces belles laitières blanches et noires qui broutent paisiblement l'herbe verte des prairies de Waikato au nord de la Nouvelle-Zélande. Vallonnée, humide et tempérée, la région est une Normandie toujours en été. Les vaches y sont tellement bien qu'elles n'ont besoin de rien : pas d'étable pour l'hiver et ses nourritures coûteuses, peu de maladies, tellement bien intégrées qu'elles sont devenues la mascotte de l'équipe locale de rugby. L'une d'entre elles aurait même réussi l'exploit, selon la presse scienti-fique, de produire directement du lait écrémé (son génome est étudié sous toutes les coutures).
Voilà bien du plaisir pour son propriétaire et sa coopérative, le géant Fonterra, le plus grand exportateur mondial de lait. La vache de Waikato est la version lactée de l'effet papillon, dont le battement des ailes est supposé provoquer un cataclysme à l'autre bout de la Terre. Il a suffi qu'il y fasse un peu plus sec qu'à l'accoutumée, en 2007, pour que la production de lait de Fonterra se tasse… et provoque une envolée des cours mondiaux. La pluie revenue, un an plus tard, les belles laitières ont repris leur production habituelle, provoquant un effondrement brutal des prix et déclenchant dans la foulée des désordres en cascade en Europe et particulièrement en France.
Car le lait est, plus encore que toutes les autres matières agricoles, un sujet d'étude extraordinaire où se mêlent étroitement, l'économique, le politique, le social et même la « civilisation », comme dirait notre président de la République. Une bonne façon de comprendre le casse-tête français et européen est de prendre du recul. Par exemple de s'installer au dernier étage du siège de Fonterra sur Princes Street, en plein centre d'Auckland. On y découvrira que l'économie laitière est sous l'emprise de trois paradoxes exceptionnels.
1. Economie de marché, prix encadrés. Le lait et ses dérivés, c'est d'abord un très gros marché. Rien qu'en France, il s'agit du premier secteur de l'industrie alimentaire avec 25 milliards d'euros. Et, dans le monde, c'est une activité en croissance de près de 2,5 % par an sous la poussée des pays émergents comme la Chine (13 % de hausse par an entre 2005 et 2008). Mais c'est aussi un sujet social. Car l'élevage laitier est structurant pour l'agriculture, dont c'est le premier métier, et donc pour les territoires. Il y a encore près de 90.000 exploitants laitiers en France.
Aucun politique ne peut se résoudre a entériner la disparition des prairies à vache qui parsèment le territoire. Si la Nouvelle-Zélande à supprimé toutes ses subventions à l'industrie laitière il y a plus de vingt ans, il n'en va pas de même des grands pays de la planète. Même des libéraux comme les Etats-Unis, le Canada ou le Japon fixent encore arbitrairement un prix du lait, fonction non pas de la demande, mais du prix de revient des producteurs. Au Canada, le prix du lait dépasse les 450 dollars, soit deux fois plus qu'en Allemagne ou en France et presque quatre fois plus que le prix de revient néo-zélandais (120 dollars). L'Europe a longtemps encadré les prix et les quantités, d'abord en rachetant les surplus de production (les fameux stocks de beurre des années 1970), puis en fixant des quotas maximaux pour limiter la surproduction. En France, jusqu'à cette année, des négociations entre producteurs, coopératives et industriels (« les trois familles ») fixaient un indice d'augmentation des prix chaque trimestre. Le lait est ainsi la matière première la plus surveillée du monde.
Mais le dispositif vole en éclats. Cette année, le gouvernement français, inquiet des hausses de prix, a interdit la négociation tripartite, au nom de la concurrence. Du côté de l'Europe, la disparition des quotas est programmée pour 2015. Tout cela à un moment où les prix mondiaux s'effondrent.
2. Export : petits volumes, grandes conséquences. C'est bien connu, le lait tourne vite. Du coup, il voyage mal. D'autant que chaque pays a développé des usages très différents. Les Anglo-Saxons boivent le lait, les Latins le mangent sous forme de fromage. Du coup les exportations de lait sont minimes. Hors circulation intra-européenne, 93 % de la production mondiale est consommée localement. Mais il y a Fonterra. La coopérative produit moins de lait que la France, mais elle en exporte 95 % et représente du coup plus du tiers du total des échanges mondiaux, plus que l'Europe, l'autre grand exportateur, qui n'écoule que 8 % de sa production hors de ses frontières. Loin de tout, le pays kiwi expédie son lait sous forme de poudre ou de beurre, qui peuvent se stocker sans problème. Mais, comme tout le monde stocke ses surplus de cette façon, et que Fonterra a des prix imbattables, il est le seul à gagner de l'argent dans ce commerce international qui alimente les pays émergents et les industriels de la transformation ou de l'élevage. C'est ainsi qu'une sécheresse à Waikato, qui ne va provoquer qu'une chute de 0,5 % de l'offre mondiale, va in fine se traduire par un doublement du prix de la poudre et du beurre, seules denrées dotées d'un prix mondial.
3) Des monopoles très libéraux. Fonterra est issu de la fusion en 2001 des deux plus grosses coopératives laitières néo-zélandaises et de l'organisme étatique qui détenait le monopole de l'exportation. L'entreprise inonde la planète comme une multinationale, mais n'a pas de concurrents chez lui. Un paradoxe extraordinaire qui se retrouve en Europe, où les pays du Nord sont les plus libéraux, adversaires des quotas et autres prix administrés, alors qu'ils sont organisés en coopératives géantes quasi monopolistiques. Ainsi, les Pays-Bas ont vu cette année fusionner leurs deux principales coopératives, Friesland et Campina. A l'inverse, la France, qui apparaît si préoccupée par le sort de ses petits producteurs, abrite un paysage beaucoup plus varié avec de multiples coopératives régionales, la seule nationale étant Sodiaal, qui ne pèsent que 40 % du secteur, le reste étant constitué d'industriels de taille souvent mondiale comme Danone, Bongrain ou Lactalis.
Evidemment, les coopératives présentent l'énorme avantage d'être proches des producteurs puisqu'elles leur redistribuent tous les profits et qu'ils peuvent influer sur leur stratégie.
En revanche, ce statut est porteur de conflits d'intérêts. Celui du producteur adhérent est de vendre son lait au meilleur prix, quand celui de la coopérative est de valoriser au mieux sa matière, en l'achetant pas trop cher et en la transformant de la façon la plus sophistiquée possible. Logique de mutuelle contre logique industrielle. D'ailleurs, quand Fonterra a voulu s'introduire en Bourse en 2007 pour augmenter son capital afin de réduire sa dette et de poursuivre son expansion internationale, il s'est heurté au refus de ses adhérents et reste surtout un spécialiste des matières de base peu valorisées, soutenu par un prix de revient imbattable.
Et si, finalement, c'était la France qui accouchait du modèle le plus complémentaire ? Avec, d'un côté, des producteurs soit de grande taille (dans l'Ouest), soit de niche (AOC, produits bio) et, de l'autre, des coopératives concentrées sur la collecte et la transformation industrielle, et des entreprises maîtrisant l'innovation, le marketing et l'international. Un modèle qui accouche pour l'instant dans une douleur que ne connaissent pas les vaches de Waikato.
PAR PHILIPPE ESCANDE, Les Echos
  |  |  |  |  |  |  | Partager : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le marché du jardin et ses perspectives
Quelles sont les stratégies des distributeurs face au ralentissement du marché et à l'évolution des modes de consommation ?
Le Guide des clubs, cercles et réseaux d'influence
Du cercle philanthropique au prestigieux think tank, du club sportif à l'association des diplômés, près de 300 clubs et réseaux sont passés en revue...
Une formation pour les professionnels du luxe :
> Le secteur du luxe à l'épreuve de la crise : panorama mondial, perspectives et problématiques stratégiques













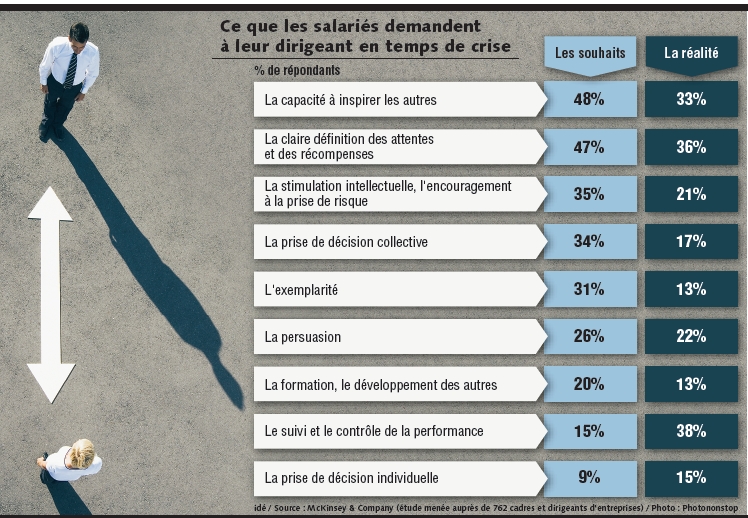














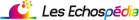










5 commentaire(s)
Réagir à cet article